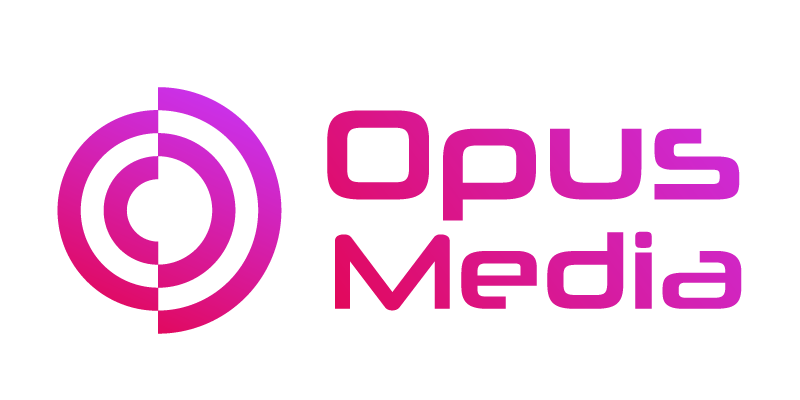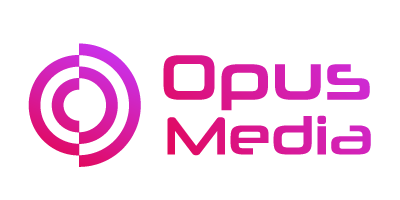En 2022, plus de 80 % des destinations dites « vertes » affichaient une hausse de fréquentation, selon l’Organisation mondiale du tourisme. Pourtant, dans certaines régions, les revenus générés par cette activité ne représentent que 5 % du chiffre d’affaires du secteur touristique local.
Des populations locales dénoncent l’accaparement des ressources et la marginalisation des acteurs traditionnels. Derrière la promesse d’un développement durable, des inégalités économiques persistent et alimentent un débat sur la répartition réelle des bénéfices.
Écotourisme : de quoi parle-t-on vraiment ?
L’écotourisme n’a rien d’une simple étiquette marketing. Il s’est imposé face à des chiffres sans appel : un tourisme mondialisé qui épuise la planète et met la biodiversité sur la corde raide. À la faveur de cette urgence, ce modèle alternatif promet de conjuguer respect de l’environnement et préservation des richesses naturelles. Mais derrière le mot, les pratiques se télescopent. Un label vert peut cacher un tourisme de masse repeint en écolo, tandis qu’ailleurs, des initiatives sincères tentent de bâtir un avenir viable pour les communautés locales.
Cette réalité plurielle se retrouve dans la diversité des approches que recouvre l’écotourisme. Voici les principales formes que prend ce secteur :
- Tourisme de nature (randonnée, observation de la faune)
- Tourisme d’aventure
- Slow tourisme
- Tourisme communautaire
- Initiatives de tourisme solidaire ou culturel
À chaque fois, la même ambition affichée : explorer, protéger, et générer des bénéfices pour celles et ceux qui vivent sur place. D’après l’Organisation mondiale du tourisme, la nature motive près d’un voyageur international sur cinq. Les critères sont clairs : faible impact écologique, participation active aux efforts de conservation et retombées concrètes pour les habitants. Les défenseurs de l’écotourisme revendiquent cette durabilité comme boussole. Mais la réalité du terrain est moins lisse : le secteur attire des opérateurs pressés de surfer sur la tendance, parfois au détriment de la cohérence et de l’éthique.
Difficile, dans ce contexte, de tracer une frontière nette entre tourisme responsable et greenwashing. La prolifération des labels, souvent autoproclamés, brouille les repères et fait planer le doute sur la sincérité de certaines démarches. Derrière les promesses, le secteur navigue entre impératifs économiques et exigences écologiques, au risque de perdre le cap.
Qui gagne quoi : entre promesses et réalités sur le terrain
L’écotourisme se veut un jeu gagnant-gagnant : communautés locales, économie de proximité, voyageurs, chacun est censé y trouver son compte. Mais la réalité, sur le terrain, s’écrit en nuances plutôt qu’en slogans. L’arrivée de touristes sensibles à l’environnement peut offrir aux villages isolés des alternatives à l’exil ou au travail agricole précaire.
Pour beaucoup de guides issus des populations autochtones, c’est l’opportunité de partager leurs savoirs et de gagner en indépendance. Ils deviennent narrateurs de leur propre histoire, passeurs de traditions parfois en danger d’oubli.
Mais tout dépend de la façon dont les projets sont menés et gouvernés. Quand les habitants sont moteurs, les retombées irriguent la région entière : emplois directs, création d’activités artisanales, développement de micro-entreprises, à l’image du Costa Rica, dont le modèle communautaire a transformé tout un tissu local, y compris pour les femmes.
La donne change radicalement lorsque des groupes extérieurs prennent la main. Les profits s’envolent, les habitants se retrouvent cantonnés à des postes subalternes, et la promesse d’un développement partagé s’effrite. Parfois, des projets affichés comme solidaires peinent à associer réellement les populations à la gouvernance ou à la valorisation de leur propre patrimoine.
L’engouement pour la nature et les cultures autochtones impose d’ailleurs un devoir de vigilance. Sans transparence sur la redistribution des gains et un vrai partage du pouvoir, l’écotourisme peut, sous couvert d’engagement, reproduire les dérives du tourisme classique et renforcer les inégalités.
Les dessous de l’écotourisme : impacts environnementaux et défis à relever
La préservation du patrimoine naturel est le pilier de l’écotourisme, mais la réalité se montre nettement plus complexe. La fréquentation massive des parcs nationaux, réserves protégées ou sites classés par l’UNESCO met sous tension les ressources locales. Faune et flore paient le prix d’un afflux parfois mal maîtrisé, et la multiplication des infrastructures, même conçues pour être discrètes, peut déstabiliser des écosystèmes déjà fragiles.
Dans certaines régions, l’apparition de phénomènes de gentrification et la flambée des prix, bien connus des grandes villes touristiques, gagnent les zones rurales prisées par les adeptes du tourisme vert. L’impact ne se limite pas à l’environnement : la vie sociale et l’économie locale peuvent elles aussi être bouleversées, alimentant un sentiment de rejet grandissant chez les habitants.
La question de la pollution, notamment liée aux transports, et la gestion des déchets restent trop souvent minimisées. Pourtant, l’Organisation mondiale du tourisme l’affirme : l’écotourisme ne doit pas se limiter à la mise en valeur de paysages préservés. Il s’agit de repenser l’équilibre entre conservation, accès et transmission des ressources naturelles et culturelles. La lutte contre la déforestation ou la gestion raisonnée des ressources exigent une vigilance de chaque instant, sous peine de voir le modèle s’effondrer sur ses propres contradictions.
Protéger les territoires, garantir la durabilité des usages, mais aussi prévenir les dérives d’un système qui, sous couvert de bonnes intentions, pourrait bien aggraver les fractures écologiques et sociales, le défi est là, concret, impossible à éluder.
Changer la donne : comment voyager sans nuire, pour un tourisme plus responsable
Les labels se multiplient sur les brochures et les sites des agences. De La Clef Verte à Pavillon Bleu, du Gîte Panda à Bienvenue à la Ferme, ces certifications dessinent le paysage de l’écotourisme et donnent des repères aux voyageurs en quête de sens. Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ou encore le label EDEN, Destination d’Excellence, sous l’égide de la Commission européenne, offrent des références pour distinguer les démarches sérieuses des simples opérations de communication verte.
Mais la vigilance ne s’arrête pas à l’obtention d’un label. Les pouvoirs publics et les ONG encadrent le mouvement, mais la responsabilité court tout au long de la chaîne : agences de voyage, opérateurs touristiques, hôteliers, guides locaux, et, surtout, les voyageurs eux-mêmes. En France, le Fonds Tourisme Durable, les recommandations portées par ONU Tourisme ou la Commission européenne témoignent de l’ampleur du chantier.
Pour agir concrètement, voici quelques pistes à privilégier lors de la préparation de son séjour :
- Privilégier les hébergements certifiés et les circuits courts
- Favoriser les activités encadrées par des guides locaux
- Interroger la traçabilité des opérateurs et l’impact réel des séjours
Réglementation, certification, labellisation : autant d’outils pour poser un cadre, mais le véritable changement s’opère dans la capacité de chacune et chacun à repenser ses choix, à s’informer, à rechercher un tourisme durable qui ne sacrifie ni la nature, ni la dignité des populations. À l’heure où les frontières entre engagement et récupération s’estompent, seule la lucidité permettra à l’écotourisme de tenir ses promesses.