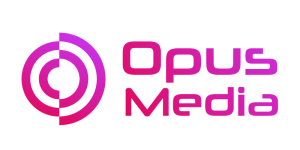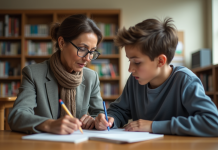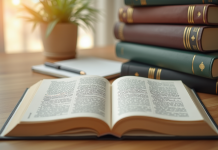0,1 %. C’est la proportion de la population qui concentre aujourd’hui plus de patrimoine que la moitié des Européens réunis. Ce chiffre, aussi net qu’inconfortable, balaie d’un revers de la main toute idée de société égalitaire à l’échelle du continent.
Plan de l'article
- Comprendre les multiples visages des inégalités en Europe aujourd’hui
- Pourquoi les écarts persistent-ils malgré la croissance économique ?
- Des politiques publiques qui font la différence : exemples concrets et résultats observés
- S’engager individuellement et collectivement : quelles actions pour une Europe plus équitable ?
Comprendre les multiples visages des inégalités en Europe aujourd’hui
La carte européenne des inégalités accroche les regards, bouscule les certitudes et jette la lumière sur une fracture qui refuse de se résorber. Sous l’apparence d’une Union européenne homogène persistante, les écarts de fortune perdurent, têtus, malgré les intentions affichées. Les données de l’Observatoire des inégalités l’illustrent : les niveaux de vie moyens restent nettement plus hauts à l’ouest qu’à l’est, loin des promesses réitérées lors des grands élargissements. Ce sont la santé, l’accès à un emploi pérenne ou la possibilité de décrocher un logement convenable qui se jouent, chaque fois, selon son pays, voire sa région de naissance.
Les inégalités territoriales se creusent et marquent l’Europe. Tandis que les campagnes se vident et s’appauvrissent, les grandes villes captent les dynamiques, les investissements, la jeunesse, tout en laissant d’immenses zones à la marge. La Banque mondiale le répète : ce fossé nourrit le sentiment d’abandon et tend la cohésion sociale, remettant en question la capacité réelle des politiques publiques à ouvrir le champ des possibles.
Les inégalités ne se résument pas à un différentiel de revenus. La question des droits sociaux pèse lourd : de nombreux États européens voient encore les femmes cantonnées à des salaires moindres et des progressions plus lentes. Beaucoup de jeunes, quant à eux, se débattent face à la précarité pour entrer dans la vie active.
Pour illustrer ces différents visages des inégalités dans toute l’Europe, on observe :
- Inégalités de santé : dans certains États, l’espérance de vie plonge de plus de dix ans d’un pays à l’autre.
- Inégalités d’accès à l’emploi : dans plusieurs régions du sud, le chômage des jeunes grimpe au-dessus de 30 %.
- Inégalités de genre : malgré les engagements, l’écart salarial entre femmes et hommes s’accroche dans bien des secteurs.
Les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU sonnent comme un rappel : le temps n’est plus à la tergiversation. L’Europe, souvent citée pour sa sécurité sociale et ses dispositifs de solidarité, compose encore avec ses contradictions profondes. L’histoire, la politique, les modèles économiques divergents : autant de racines à des inégalités bien ancrées.
Pourquoi les écarts persistent-ils malgré la croissance économique ?
L’économie européenne affiche des taux de croissance séduisants. Mais derrière les moyennes, la réalité met à nu les disparités : le revenu grimpe, la fracture des revenus aussi. Ce n’est pas une illusion. Les très hauts revenus capturent la plus grande part des fruits de la croissance, alors que la majorité stagne. Les mécanismes de redistribution, jadis étendards du modèle social européen, perdent de leur mordant.
Dans plusieurs États membres, le taux d’imposition sur les plus aisés a fondu. Les contributions, qu’il s’agisse de la CSG ou de la TVA, pèsent surtout sur les revenus moyens et faibles. L’impôt sur le revenu remplit moins sa mission de rééquilibrage, au point que les recettes de la contribution sociale généralisée ne compensent plus vraiment.
S’ajoute à cela une évasion fiscale qui met à mal la solidarité : capitaux discrets, fortunes nomades, manque de volonté politique pour resserrer les mailles du filet. La mobilité sociale reste figée ; le paysage de l’emploi se morcelle au rythme des nouvelles formes d’emploi, souvent synonymes de précarité davantage que de liberté.
Le socle que constituait la protection sociale s’est trouvé fragilisé, notamment après les chocs du Covid : filets moins solides, failles difficilement comblées, vulnérabilités accrues. Les tensions entre pays membres s’approfondissent. En France, la redistribution s’est affaiblie, prise entre la réduction des dépenses publiques et une explosion des besoins sociaux.
Des politiques publiques qui font la différence : exemples concrets et résultats observés
La réduction des inégalités n’a rien de théorique : des actions publiques fortes ont prouvé leur efficacité, lorsque le cap est maintenu. En France, par exemple, l’accent mis sur les services publics, santé, éducation, transports, a limité le fossé entre riches et pauvres dans plusieurs territoires. L’accès gratuit à l’école, pilier éducatif, accroît les chances d’une réelle égalité dès le plus jeune âge, même si son impact reste inégal selon la localisation.
Les pays scandinaves font figure de référence : une fiscalité élevée sur les hauts revenus finance une protection sociale solide, véritable rempart contre les accidents de la vie. Au Danemark, un système de formation professionnelle performant s’ajoute à la création d’emplois stables, ce qui réduit concrètement les écarts et favorise la mobilité sociale.
Quelques résultats tangibles montrent comment certains pays européens ont infléchi la courbe des inégalités :
- En Allemagne, investir massivement dans la formation des adultes a fait nettement reculer le chômage de longue durée.
- Aux Pays-Bas, le renforcement des allocations familiales a entraîné une baisse mesurable de la pauvreté chez les enfants.
Ces stratégies, associées à la coordination des politiques sociales, freinent la divergence des niveaux de vie. L’équilibre reste fragile cependant, sur fond de compétition fiscale et de budgets publics sous tension. Renoncer à la justice sociale n’est pas une option – même lorsque la pression s’intensifie.
S’engager individuellement et collectivement : quelles actions pour une Europe plus équitable ?
L’engagement contre les inégalités ne se construit pas seulement dans les bureaux des institutions. Des citoyens, des associations, des initiatives collectives se mobilisent chaque jour. Ils réinventent l’accès au logement, accompagnent la réinsertion vers l’emploi, tissent des réseaux d’entraide là où les dispositifs publics montrent leurs limites.
Les syndicats, ONG, collectifs agissent pour l’égalité des droits : ils donnent la parole à ceux qu’on n’écoute pas, documentent les injustices, poussent les décideurs à revoir leurs copies. L’engagement prend mille formes : défendre la protection sociale, s’opposer à la discrimination, relayer les initiatives qui favorisent réellement la cohésion.
Voici plusieurs manières concrètes de s’impliquer pour faire bouger les lignes en Europe :
- Appuyer les services publics en s’impliquant dans les conseils d’école, les instances hospitalières ou locales.
- Demander davantage de transparence dans la gestion des financements destinés à combattre les inégalités à l’échelle européenne.
- Favoriser l’inclusion dans l’emploi, encourager l’accès à la formation professionnelle pour celles et ceux en situation de précarité.
L’information indépendante reste l’un des leviers les plus puissants. Les chiffres transmis par les institutions, les analyses sur les droits sociaux, nourrissent le débat et renforcent le rôle de contre-pouvoir. Cette dynamique démocratique ne connaît pas de pause : la capacité de chacun à interroger, proposer, porter la voix de ceux qui comptent peu dans les statistiques fait avancer toute l’Europe.
Mettre fin aux inégalités sur le continent européen ne tient ni du rêve ni de la fatalité. Il y faut de l’audace, de l’obstination, et la volonté d’essayer de nouvelles voies. Si la norme d’une Europe plus juste paraît lointaine, elle se dessine chaque jour dans l’action de celles et ceux qui refusent la résignation.